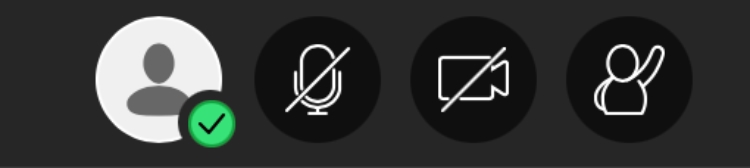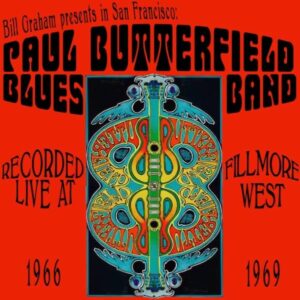Between the Buttons reste le grand mal-aimé, et sans doute le plus injustement méconnu de la discographie des Rolling Stones. Sorti au tout début de l’année 1967, il consacre l’affranchissement définitif du groupe avec la musique noire des années 50 et du début des années 60 et leur remarquable capacité à se saisir de l’air du temps pour en tirer comme une forme de quintessence. A ce titre, Between the Buttons transcende à la fois la pop naïve des Beatles, la satyre sociale des Kinks, la violence brute des Yardbirds ou des Who et vient parfois se confronter à la poésie un brin loufoque de Bob Dylan. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.
Between the Buttons reste le grand mal-aimé, et sans doute le plus injustement méconnu de la discographie des Rolling Stones. Sorti au tout début de l’année 1967, il consacre l’affranchissement définitif du groupe avec la musique noire des années 50 et du début des années 60 et leur remarquable capacité à se saisir de l’air du temps pour en tirer comme une forme de quintessence. A ce titre, Between the Buttons transcende à la fois la pop naïve des Beatles, la satyre sociale des Kinks, la violence brute des Yardbirds ou des Who et vient parfois se confronter à la poésie un brin loufoque de Bob Dylan. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.
SWINGING LONDON
 En janvier 1967, Londres est devenu la capitale incontestée de la mode et de la culture pop. Antonioni vient d’y tourner « Blow up« , futur vainqueur du festival de Cannes, où il expose une ville sans cesse en mouvement, qui grouille d’une vie culturelle intense, rebelle sans être contestataire, et où la jeunesse semble avoir trouvé des modes d’expression nouveaux, loin des canons anciens. Mais ce qui est vrai à Londres, à cette époque, ne l’est ni dans la France de de Gaulle, terriblement conformiste, ni dans une Allemagne en pleine reconstruction, ni aux Etats-Unis où la contre-culture underground commence tout juste à émerger en ce début d’année. Cette période riche, si particulière et si flamboyante en un sens sera pourtant très rapidement oubliée, au profit de l’émergence du Flower Power quelques mois plus tard. Elle sera cependant revivifiée par le mouvement Punk, dix ans plus tard, la contestation en plus !
En janvier 1967, Londres est devenu la capitale incontestée de la mode et de la culture pop. Antonioni vient d’y tourner « Blow up« , futur vainqueur du festival de Cannes, où il expose une ville sans cesse en mouvement, qui grouille d’une vie culturelle intense, rebelle sans être contestataire, et où la jeunesse semble avoir trouvé des modes d’expression nouveaux, loin des canons anciens. Mais ce qui est vrai à Londres, à cette époque, ne l’est ni dans la France de de Gaulle, terriblement conformiste, ni dans une Allemagne en pleine reconstruction, ni aux Etats-Unis où la contre-culture underground commence tout juste à émerger en ce début d’année. Cette période riche, si particulière et si flamboyante en un sens sera pourtant très rapidement oubliée, au profit de l’émergence du Flower Power quelques mois plus tard. Elle sera cependant revivifiée par le mouvement Punk, dix ans plus tard, la contestation en plus !
UN –GRAND– DISQUE À PART
Between the Buttons est le dernier album des Rolling Stones paru en deux versions différentes –l’une pour l’Europe, l’autre pour les Etats- Unis-. Si la version américaine fut pendant longtemps la plus aisée à trouver, son pendant européen est largement préférable, et on poussa la compléter complété par les singles «Let’s Spend The Night Together» –aussitôt interdit en radio-, et « Ruby Tuesday », avec violoncelle et flûte à bec, quasi-contemporains et participant de la même veine esthétique.
PAS DE BLUES, MAIS DE LA MYSOGINIE À REVENDRE…
Album de transition entre leur attachement au blues du début et la période dorée 1968-1972, Between the Buttons est incontestablement, musicalement parlant, le moins bluesy de leurs albums chez Decca. Thématiquement, cependant, on y retrouve tous les ingrédients qui ont fait la légende du groupe depuis ses débuts : le sexe et la drogue –« Connection » est très explicite à ce sujet-, une misogynie rampante, une gouaille exacerbée, ce côté sale gosse qui attire les adolescents et révulse copieusement leurs parents, dans un instrumentarium rénové et enrichi –vibraphone, clavecin, bandonéon, trombone, cornet à piston…-. De nombreux titres ont été conçus au piano (tonalité de do majeur), la guitare de Brian Jones est peu présente, mais les riffs de Keith Richards deviennent plus amples, même s’il n’a pas encore découvert les accords en open-tuning.
Pour autant, les thèmes propres aux Rolling Stones continuent à y être abordés selon la marque de fabrique qui les singularise dans leur rapport à la gente féminine : « Yesterday’s Papers » –première chanson composée par un Stone tout seul, en l’occurrence Mick Jagger– vient enrichir la vision consumériste des femmes déclinée par le groupe depuis ses origines; « Miss Amanda Jones » dépeint la liaison courte et sulfureuse entre Brian Jones et Amanda Lear; « All Sold Out » présente une lettre de rupture teintée d’amertume; surtout, « Back Street Girl », d’une grande cruauté malgré la douceur tendrement nostalgique de sa musique, témoigne de la place dévolue aux femmes par ses membres : des relations d’arrière-cour.
L’illustration de la pochette de l’album a été réalisée durant ce qui constitue sans aucun doute leur plus belle séance de photographies, par le photographe Gered MANKOWITZ dans le parc de Primrose Hill, fin 1966. Teints blafards du petit matin, dans la brume hivernale d’une Londres encore endormie et au sortir d’une nuit de débauche. Le photographe aime à rappeler qu’à cette époque, les Rolling Stones ne dormaient jamais, ce qui conduisait à des séances chaotiques, et que les musiciens pouvaient se montrer volontiers rétifs, voire agressifs. Remercié à la fin de l’année par les Rolling Stones, MANKOWITZ ne travailla plus qu’une fois avec eux, en 1982, quand Mick Jagger le limogea en ces termes peu amènes : «Dégage, tu nous rappelles de mauvais souvenirs !».
Provisoirement retirés de la scène après des années de concert harassants, Between the Buttons vient ainsi symboliser la fin d’une ère, celle de l’adolescence : une adolescence chaotique et houleuse, très loin de l’image idyllique proposée par les Beach Boys dans « Pet Sounds », paru une petite année auparavant. Il confirme également l’entrée des Rolling Stones dans une nouvelle voie, plus personnelle.
Contrairement aux idées reçues, Between The Buttons fut très bien reçu à sa sortie –n°3 UK durant 22 semaines et et n°2 US durant 9 semaines– et donna lieu à de fortes ventes. La suite de l’année s’avéra des plus problématiques : procès et prison pour Mick Jagger, Keith Richards et Brian Jones. Ce dernier, d’ailleurs, n’y résistera pas, et cet album constitue en quelques sortes son chant du cygne.