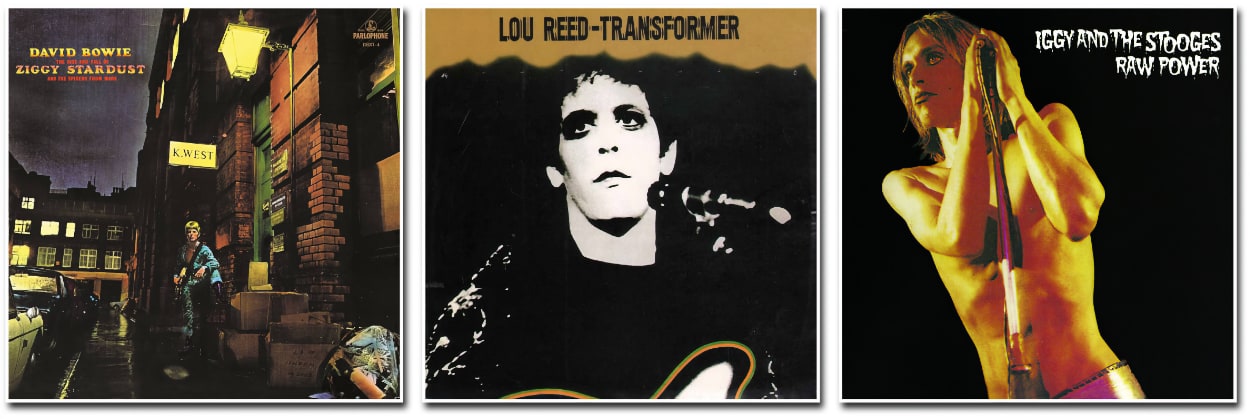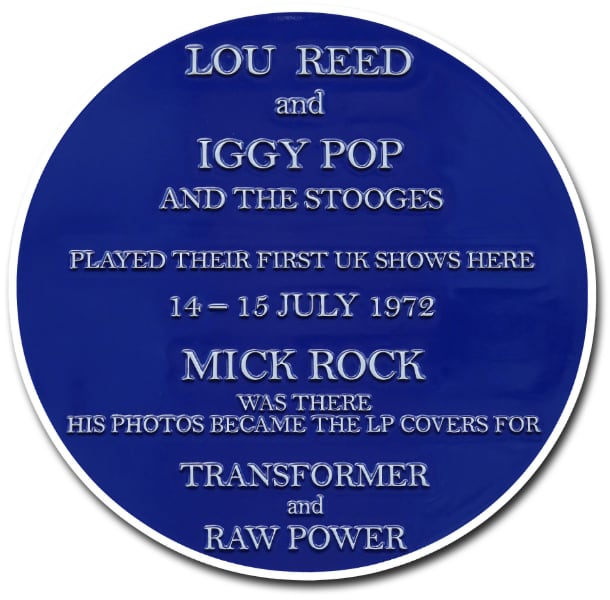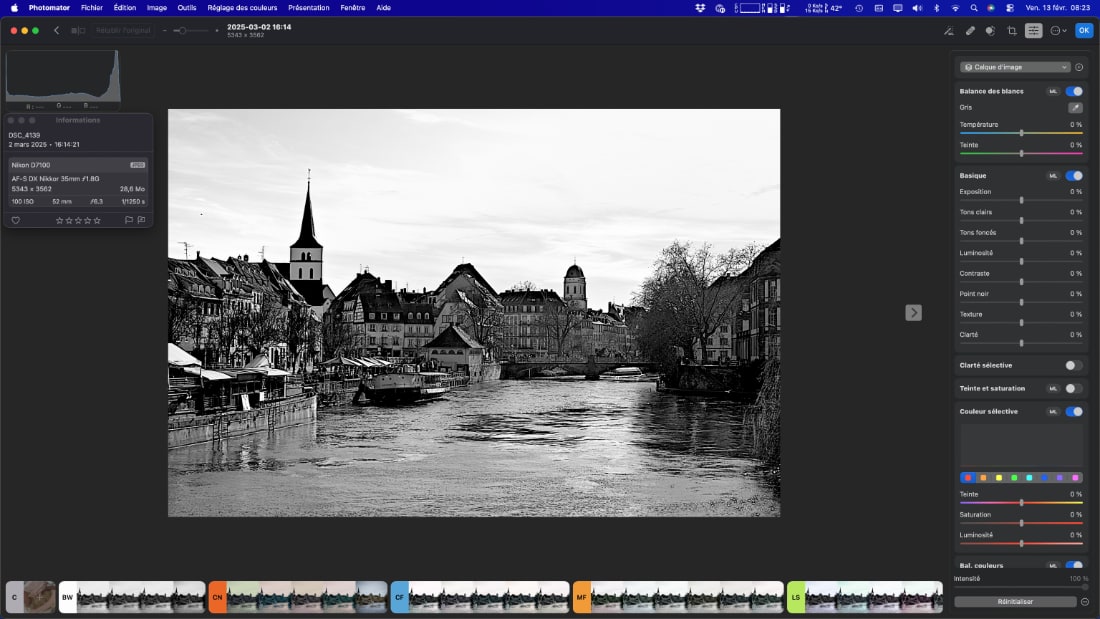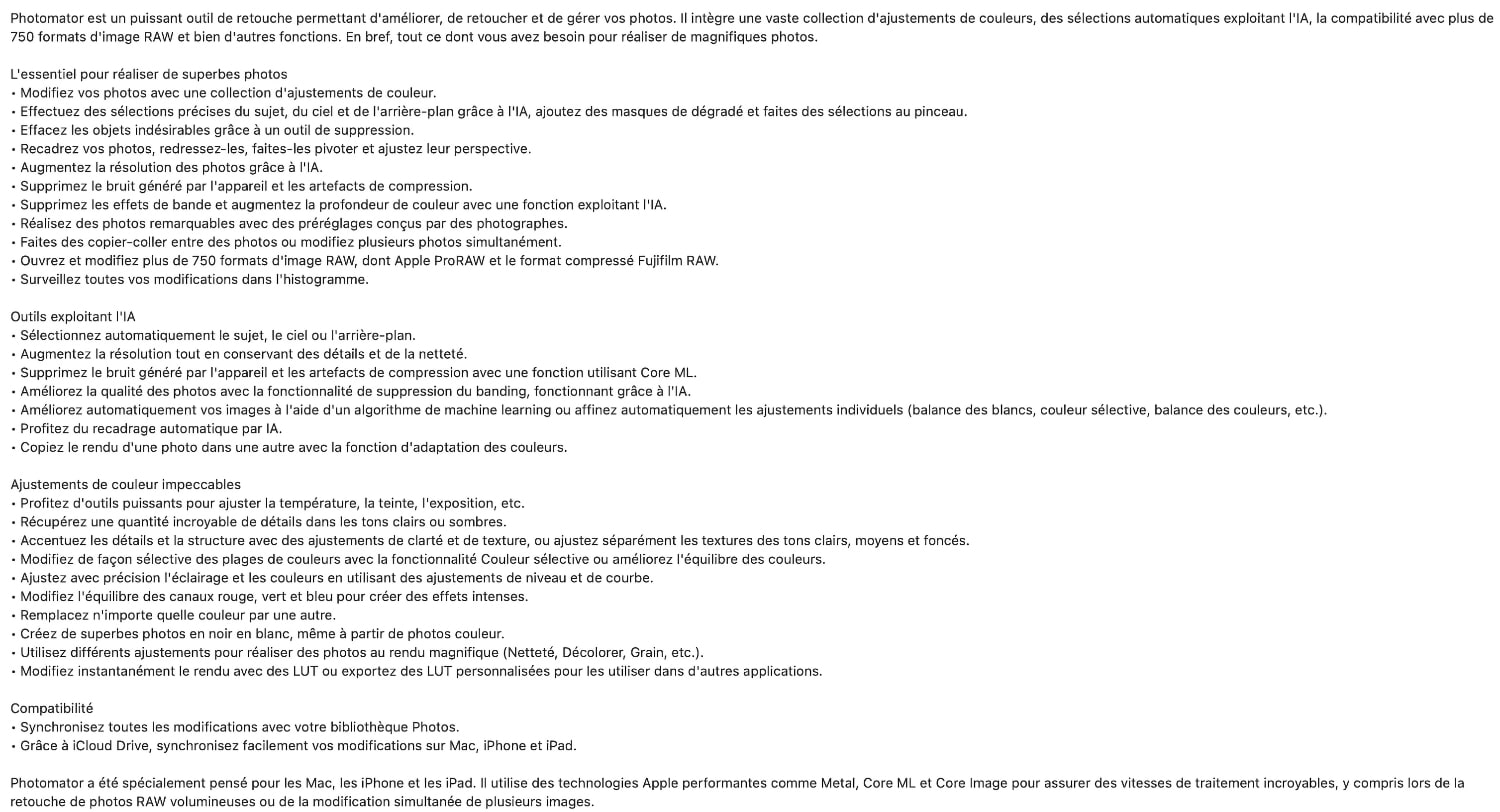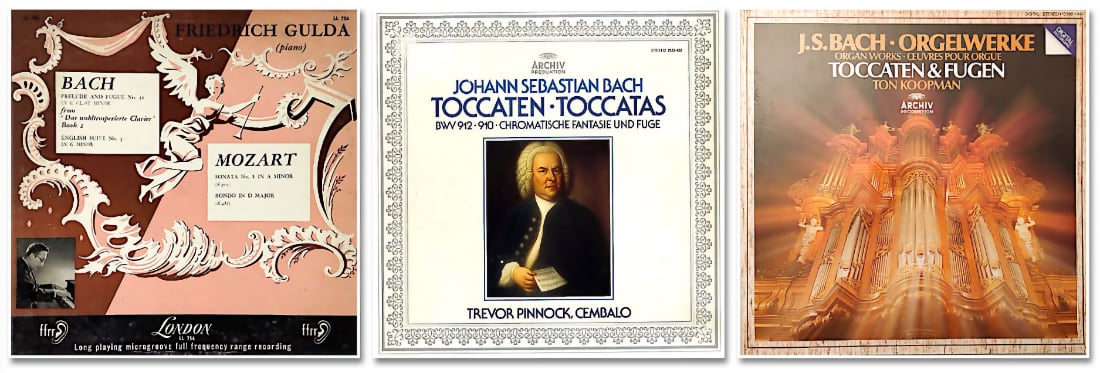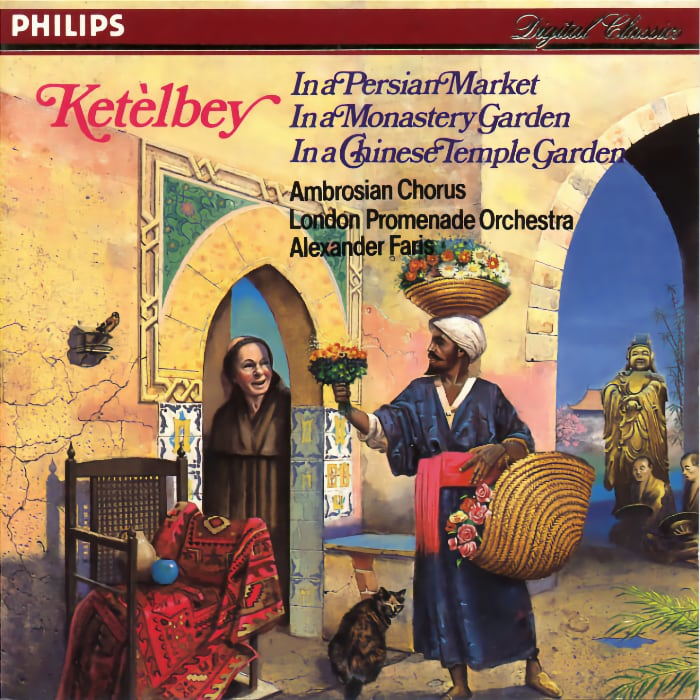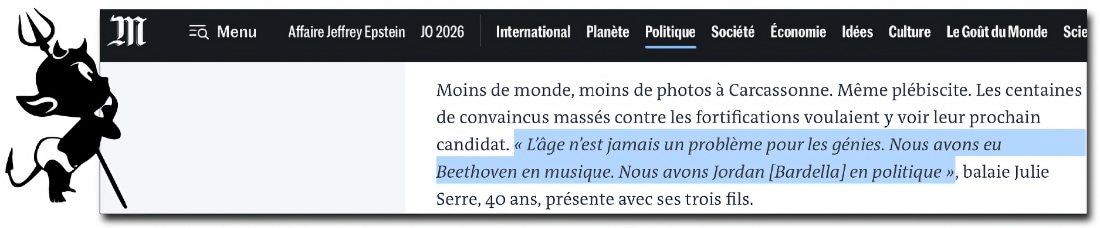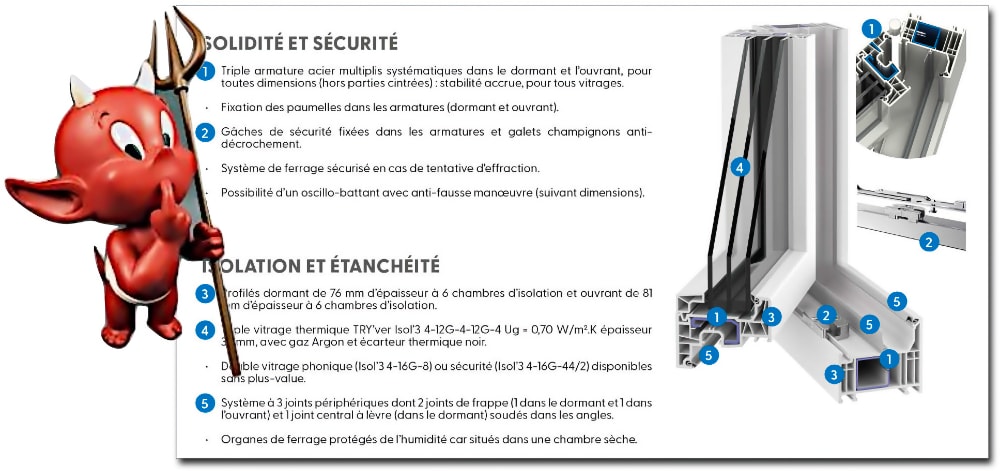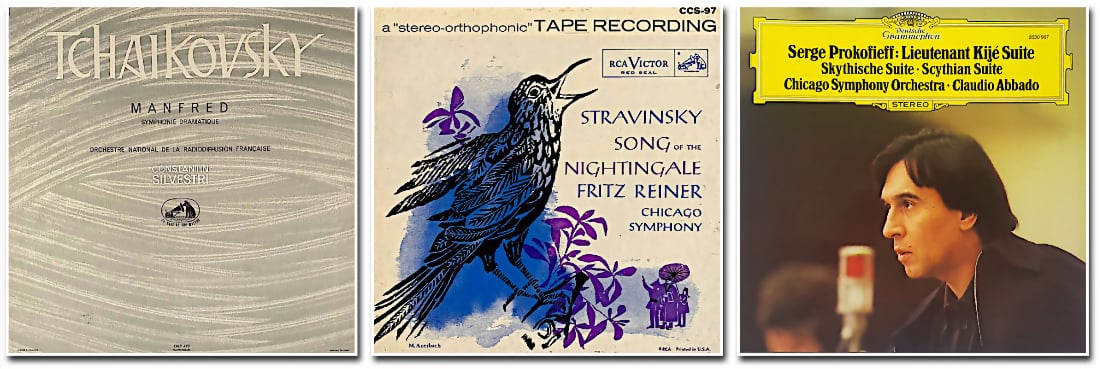Dimanche à l’opéra – « Trial By Jury », de Gilbert & Sullivan
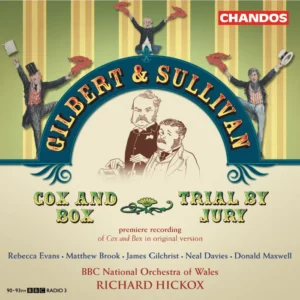 Cette matinée lyrique dominicale est consacrée à une opéra-comique anglais –une cantate dramatique en un acte– extrêmement court –une trentaine de minutes à peine– du duo Gilbert –librettiste– et Sullivan –compositeur-. Il s’agit de l’une des première collaboration de ce duo, qui allait se montrer prolifique dans le dernier quart du 19è siècle –une quinzaine d’oeuvres réalisées en collaboration-. Comme pour la plupart des opéras de Gilbert et Sullivan, l’intrigue de Trial by Jury est ridicule, mais les personnages se comportent comme si les événements étaient parfaitement raisonnables : cela permet de décrire les petits et les grands travers des institutions anglaises et le grotesque de leurs représentants. Ici, c’est le monde de la justice qui est ridiculisé !
Cette matinée lyrique dominicale est consacrée à une opéra-comique anglais –une cantate dramatique en un acte– extrêmement court –une trentaine de minutes à peine– du duo Gilbert –librettiste– et Sullivan –compositeur-. Il s’agit de l’une des première collaboration de ce duo, qui allait se montrer prolifique dans le dernier quart du 19è siècle –une quinzaine d’oeuvres réalisées en collaboration-. Comme pour la plupart des opéras de Gilbert et Sullivan, l’intrigue de Trial by Jury est ridicule, mais les personnages se comportent comme si les événements étaient parfaitement raisonnables : cela permet de décrire les petits et les grands travers des institutions anglaises et le grotesque de leurs représentants. Ici, c’est le monde de la justice qui est ridiculisé !
L’action se déroule dans une salle d’audience. Un jeune homme, Edwin, est poursuivi pour rupture de promesse de mariage par une jeune femme, Angelina, qu’il a séduite puis abandonnée. Le jury, influencé par l’huissier, se montre d’emblée très rapidement très favorable à la plaignante, tandis que le juge, personnage vaniteux et ridicule, se révèle avant tout préoccupé par son propre passé sentimental plutôt que par l’impartialité de la justice.
Au fil du procès, les témoignages et les plaidoiries dégénèrent en comédie : la défense du prévenu est maladroite, son avocat prend le partir d’Angelina, le jury se laisse guider par l’émotion, et le juge abuse de son autorité de manière grotesque. Comme le juge est très imaptient de régler les choses et de s’en aller, il décide finalement d’épouser lui-même Angelina, proposition qui rencontre l’approbation de tous ! Finalement, tout est bien qui finit bien…
Pour autant, derrière toute cette légèreté », l’opéra dénonce l’hypocrisie sociale et la façade morale de la société victorienne, où les apparences (comme la souffrance feinte d’Angela) priment sur la vérité. Le mariage y est présenté comme une transaction financière plutôt qu’une union romantique. Quant au procès, il est traité comme une pièce de théâtre, où les rôles sont joués pour le public plutôt que pour rendre une véritable justice.
Je ne connaissais pas du tout, et je découvre au gré de mes pérégrinations, ce monde lyrique anglais, entre opéra-comique et opérette, riche en ironie satirique. L’oeuvre, dont la première représentation se déroula en 1875, connut très rapidement un très grand succès en Angleterre et au Royaume-Uni, mais sa popularité n’a jamais excédé ces frontières. Le public victorien a adoré la satire mordante et la musique entraînante, ce qui a consolidé la réputation du duo et l’a entraîné à poursuivre sa collaboration. Musicalement, on est assez proche de certaines opérettes d’Offenbach, le talent orchestral en moins cependant, et cela s’écoute avec beaucoup de facilité. Sullivan compose des airs simples, faciles à mémoriser et souvent humoristiques, inspirés de la musique populaire britannique. Le chœur, qui représente le public dans la salle d’audience, joue un rôle actif en commentant l’action et en renforçant l’aspect participatif de la comédie.
Belle version de l’orchestre national de la BBC galloise, avec des chanteurs qui semblent s’en donner à coeur-joie ! Au final, une belle découverte ! Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.