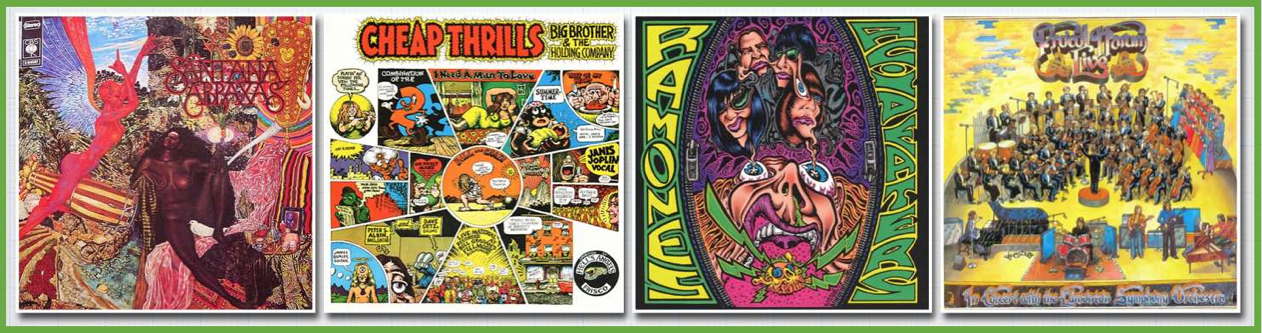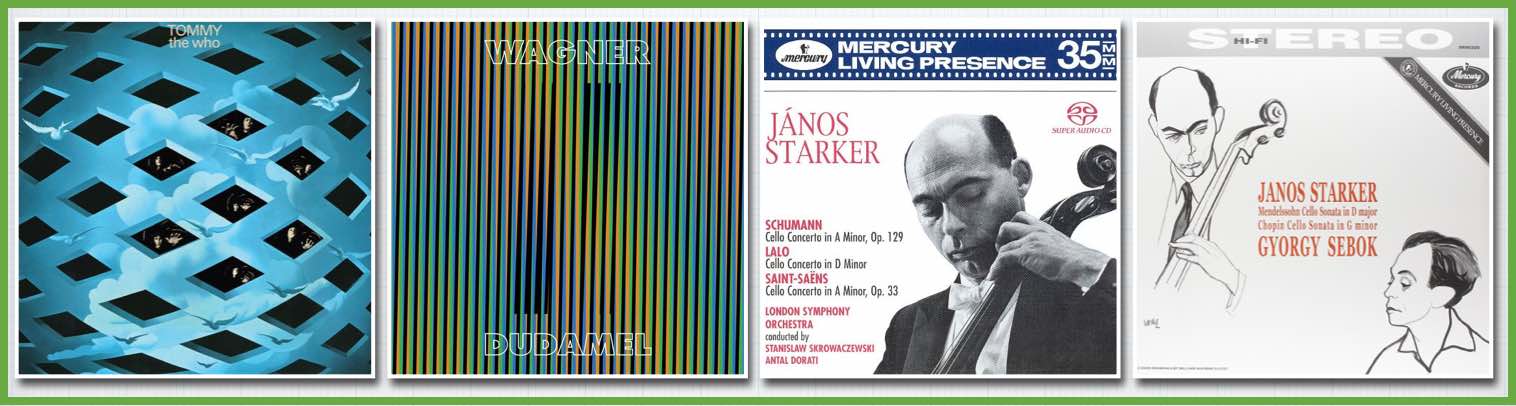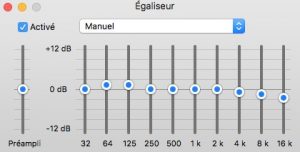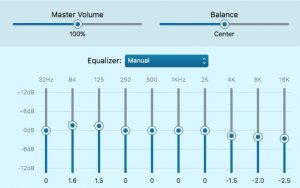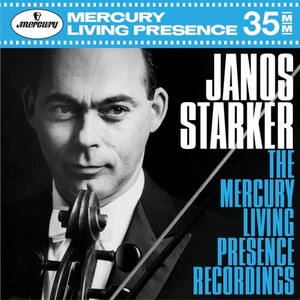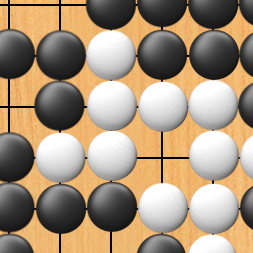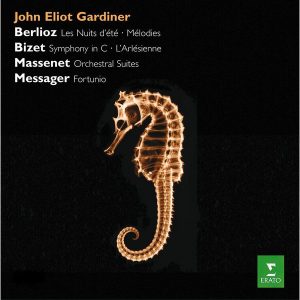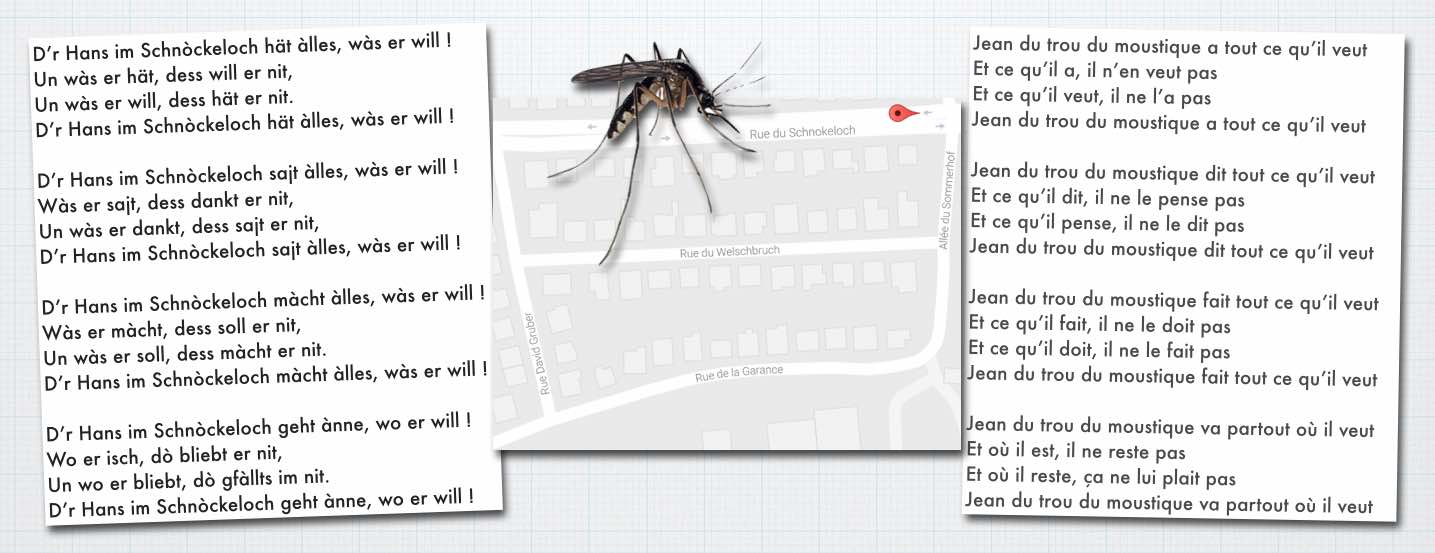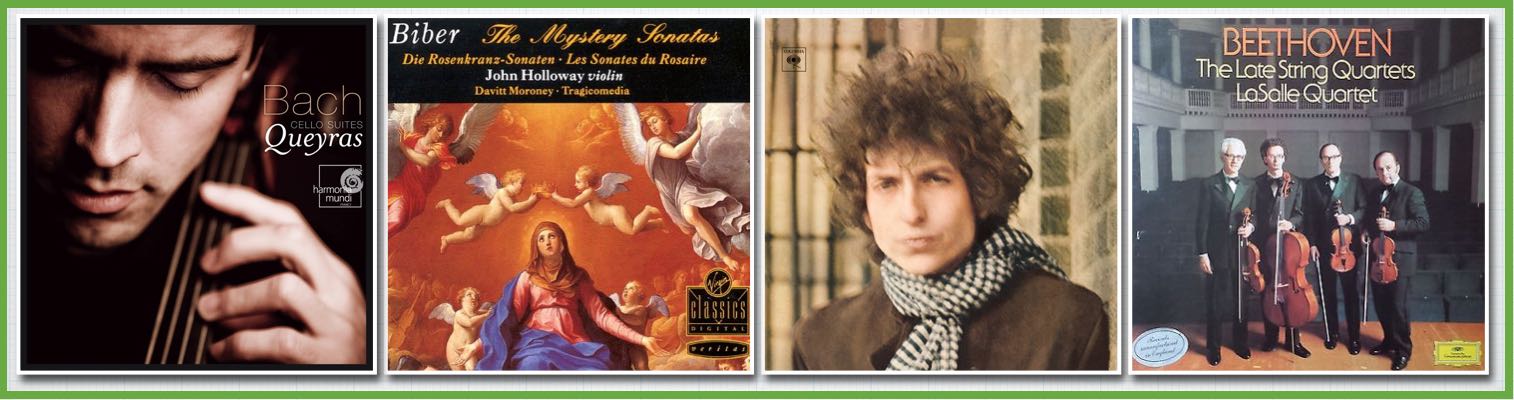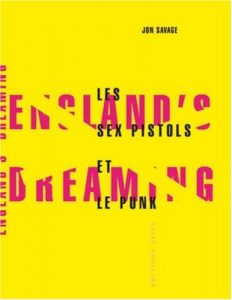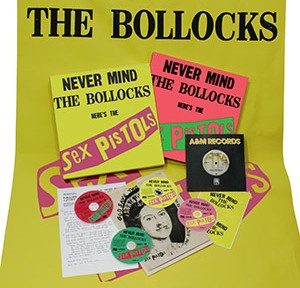Lord Of The Rings et Strasbourg : quels liens ?
 On peut voir actuellement une assez belle exposition consacrée à la saga de Tolkien « Lord Of The Rings » à Strasbourg, en lien avec le Château du Haut-Koenigsbourg, qui connut une histoire particulièrement tourmentée.
On peut voir actuellement une assez belle exposition consacrée à la saga de Tolkien « Lord Of The Rings » à Strasbourg, en lien avec le Château du Haut-Koenigsbourg, qui connut une histoire particulièrement tourmentée.
A priori, les liens semblent ténus entre Strasbourg/le Bas-Rhin et Aragorn ou Gollum, non ? Et pourtant… Il apparaît que le directeur artistique de la trilogie des films, John Howe, a fait ses études à l’École supérieures des Arts décoratifs de Strasbourg, et que c’est sa passion pour cet univers « médiéval-fantasy », déjà notable dans un très beau livre d’illustrations consacré aux gargouilles de la cathédrale de cette ville, qui a attiré l’attention du réalisateur des films, Peter Jackson.
Ce dernier qui l’a donc embauché pour créer les décors et les costumes desdits films –puis de leur suite, qui se passe en réalité antérieurement, « Le Hobbit »-, ainsi que l’ensemble du décorum architectural, pour lesquels John Howe s’est largement inspiré du château du Haut-Koenigsbourg et de son mobilier, donc, mais également de quelques-unes des armes défensives des soldats médiévaux gardant le château –gantelets, casques notamment-. Le parallèle entre être les deux mondes est, pour le coup, très intéressant.
Certaines figurines de résine sont époustouflantes de réalisme et « grandeur nature », mais la prise de photographies est assez complexe, du fait d’une lumière faiblarde et de l’exposition de nombreuses « statues » derrière des vitrines, ce qui occasionne des reflets difficiles à maîtriser dans de bonnes conditions. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand. Les images sont en assez basse résolution, malheureusement…-.