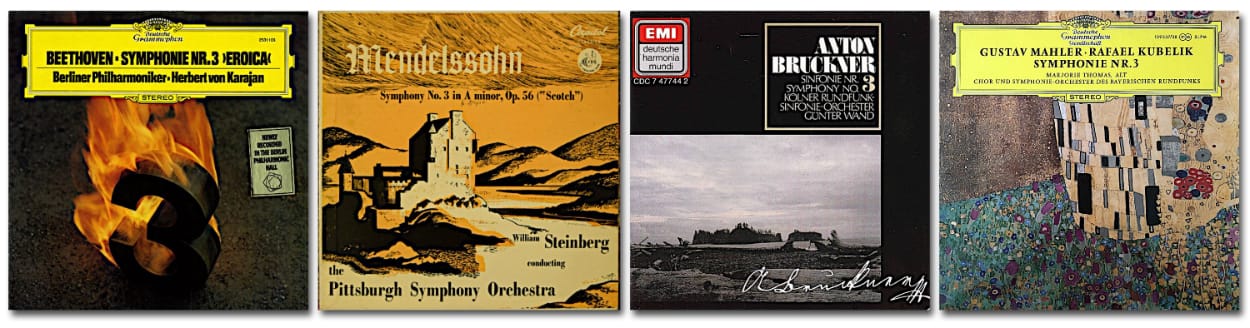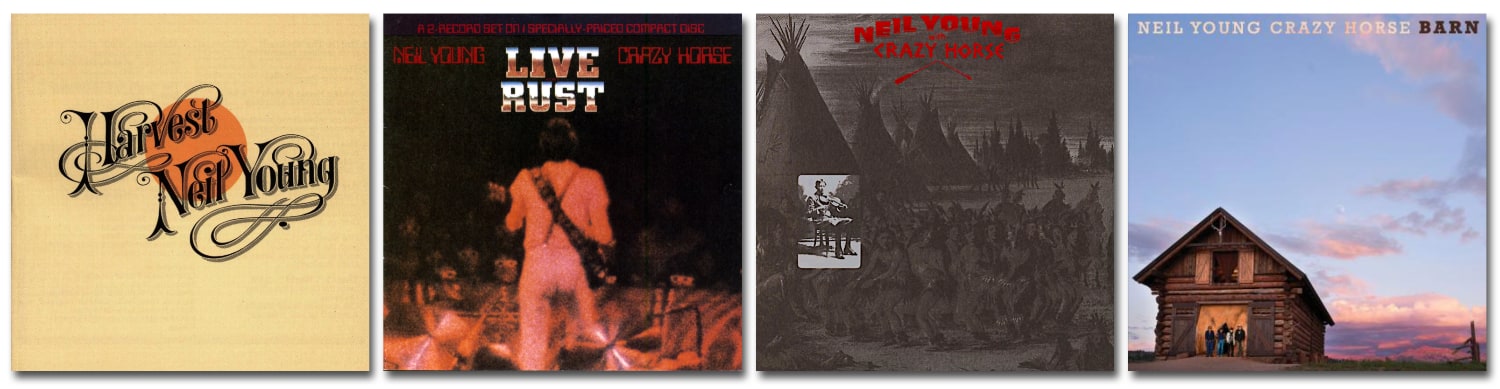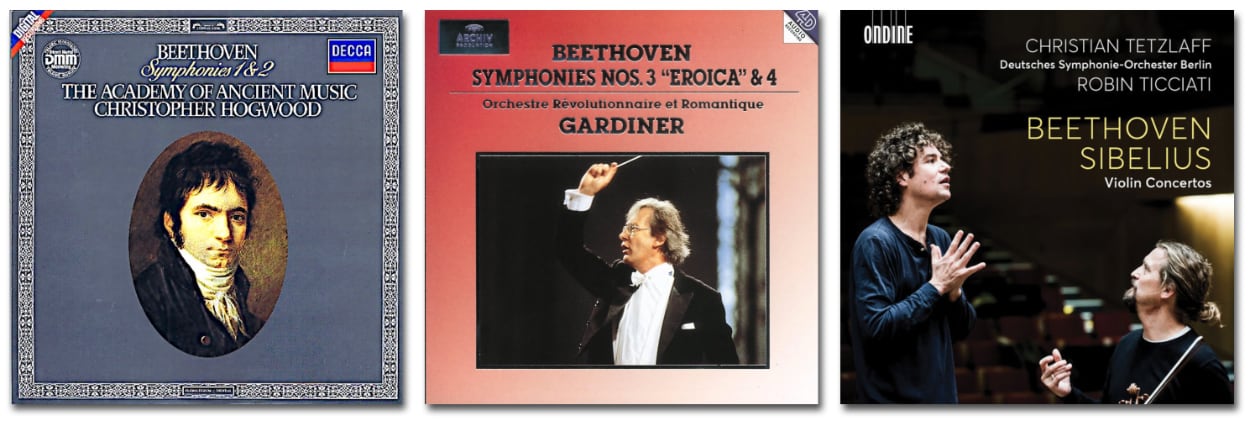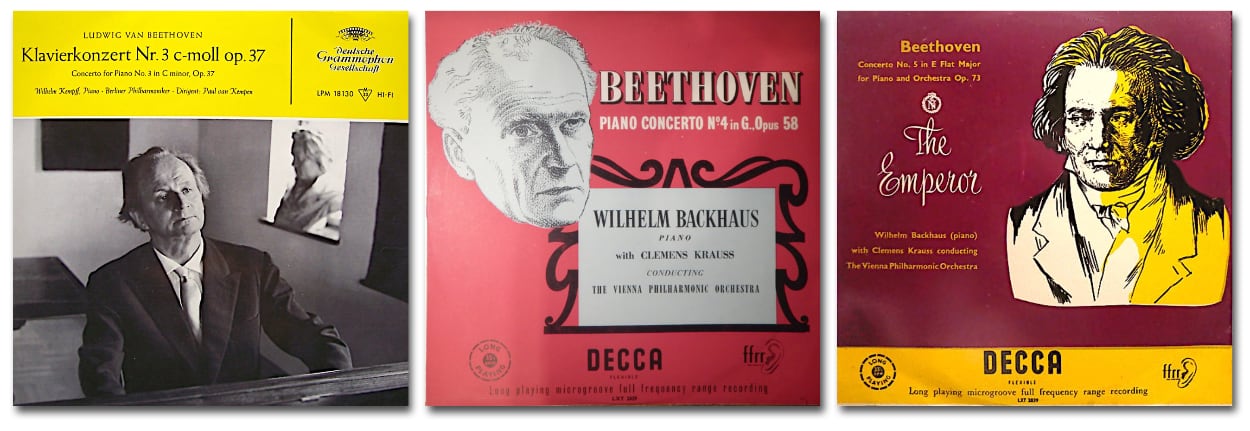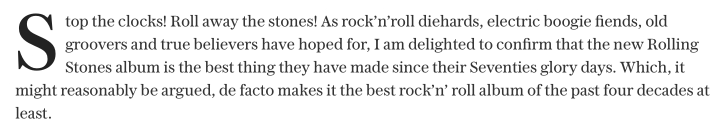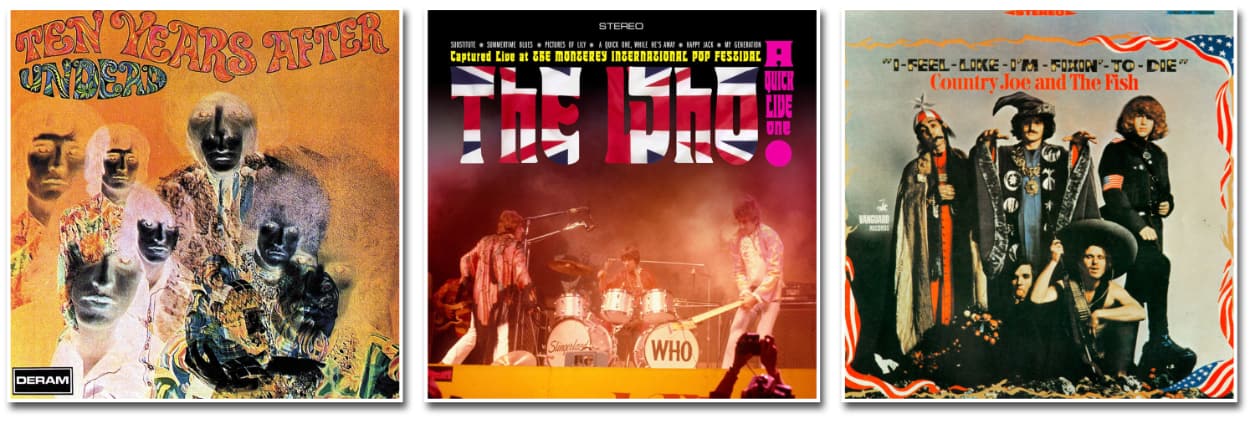Bilan 2023 – Les coups de coeur de cette année !
Comme la quantité de CD que j’achète a une très nette tendance à se réduire depuis deux ans –faute de place, d’une part, et faute de nouvelles sorties réellement palpitantes à mes oreilles– la liste de mes coups de coeur sera relativement réduite pour 2023.
En corollaire, je n’ai qu’une seule déception à signaler, et qui confirme en réalité l’idée que je m’étais fait de cette chose il y a très longtemps, et qui ne vaut pas le coup de s’y étendre sur une notule : la déception de 2023 est le live des Kinks « One For The Road », que j’ai racheté cette année parce que d’autres albums du groupe ont largement égayé mes oreilles ces derniers mois. Je l’avais déjà acheté au début des années 80 en double LP, je n’avais pas trop aimé, et cette appréciation est confirmée cette année : ça ne vaut pas mieux en CD !
Pour le reste, donc, que des coups de coeur, et vous ne serez pas trop surpris d’y retrouver le beau et volumineux coffret -99 CD- consacré à Trevor Pinnock et à l’English Concert, et, évidemment, le nouvel album des Rolling Stones « Hackney Diamonds », où, sur un titre, c’est le groupe au grand complet qu’on retrouve, avec Charlie Watts et Bill Wyman : peu ou prou 400 ans à eux cinq ! –Cliquer sur l’image our la voir en plus grand-.